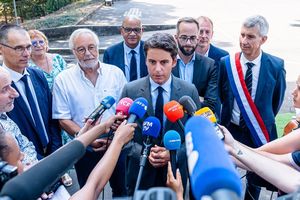« A nous de créer nos clubs et de rentrer dans les cercles de pouvoir »
Table ronde// Le 5 février, nous avons reçu quatre directrices d'école du supérieur. Comment ces dirigeantes préparent-elles les jeunes étudiantes, et étudiants, à devenir des leaders de demain ? Avec quelle philosophie, quelles priorités ? Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de notre dossier « Les Femmes déterminées à gagner la parité » à paraître avec Les Echos ce lundi 22 février.

Par Julia Lemarchand, Florent Vairet, Camille Wong, Ariane Blanchet
Sous la pression des étudiants, de la société, et aussi des entreprises, les grandes écoles ont conscience que la question de l'égalité femmes-hommes doit être prise à bras-le-corps. Pour cela, il faut repenser le leadership, les rapports entre les hommes et les femmes, tordre le cou aux stéréotypes et monitorer les progrès (voir encadré), nous ont confié Sophie Viger, à la tête de 42 ; Alice Guilhon, directrice de Skema Business School et présidente du Chapitre des écoles de management de la Conférence des grandes écoles (CGE) ; Anne Lalou, fondatrice et directrice de la Web School Factory ; et Florence Dufour, fondatrice et directrice de l'Ecole de biologie industrielle (EBI), et présidente du concours commun Puissance Alpha, regroupant quinze grandes écoles d'ingénieurs.
Être une femme directrice d'une grande école, sentez-vous parfois que c'est encore incongru dans le regard de vos interlocuteurs ?
Alice Guilhon (AG) : Plus maintenant. Lorsque j'ai été nommée à la tête de Skema, il y a treize ans, c'était étonnant : j'étais la première femme directrice d'une école de commerce. J'ai compris que j'allais être mise sous surveillance parce que j'étais une femme et, en plus, de moins de 40 ans. Les choses ont changé.
Sophie Viger (SV) : A ma nomination, fin 2018, le fait d'être une femme a été relevé, souligné dans la presse, et le fait que vous posiez la question montre que ce n'est pas encore tout à fait « normal ». Il est vrai que je suis arrivée en affichant une politique volontariste très forte en matière de féminisation. Forcément, ça déstabilise un système. Les gens ont peur, peur d'être dévalorisés et impactés personnellement. Donc oui, il y a eu des défiances. Mais elles ont été levées point par point.
Anne Lalou (AL) : J'ai créé l'école en 2012 en posant le « girl power » comme un parti pris dès le premier jour. Je n'ai pas eu de souci autour de cela.
Florence Dufour (FD) : J'ai créé l'EBI en 1992, j'avais 29 ans. Parce que je m'entendais bien avec les élèves, on m'a dit que j'étais la directrice du BDE [bureau des élèves]. Au-delà de cette anecdote, j'ai toujours évolué dans des univers masculins (j'ai fait une filière vétérinaire). Je voulais montrer que je pouvais y arriver, comme eux. J'ai été acceptée dans leur cercle, mais parfois c'était bizarre : au dîner avec les administrateurs, il y avait des blagues qui disaient qu'on était « entre hommes »…
Sur les 214 grandes écoles françaises membres de la CGE, seules 15 % sont dirigées par une femme (données 2019). Ce nombre est à l'image de ce que l'on voit dans les entreprises… Comment se fait-il que les grandes écoles ne montrent pas plus la voie ?
AG : Le monde académique n'est pas épargné par le plafond de verre. Dans notre domaine, il y a même une majorité de filles qui font des thèses, mais quand on arrive aux instances dirigeantes, elles disparaissent. Il y a toujours les explications classiques, comme le fait d'arrêter sa carrière pour se consacrer à ses enfants. Après, 15 %, c'est déjà énorme, sachant qu'on était à 0 % dans les écoles de commerce, il y a treize ans. Pour les écoles d'ingénieurs, c'est plus difficile, car le vivier de femmes professeures ne dépasse pas les 25 %.
Il serait bien qu'on pointe les secteurs en retard et ceux qui font des efforts, et qui ne discriminent plus.
Florence dufourFondatrice et directrice de l'EBI
FD : Mais le progrès y est aussi rapide : il n'y avait que 2 % de femmes dirigeantes au début des années 2000, contre un peu plus de 10 % aujourd'hui. Reste que, une fois arrivées dans les cercles de pouvoir, il y a toujours et encore cette tentation de mettre les femmes sur les questions associées à la vie sociale, la santé, la cohésion, plutôt qu'au pilotage financier, managérial. C'est pénible. J'estime que c'est ma responsabilité de promouvoir des femmes à des postes clés. Pour cela, je convertis par exemple les congés maternité en schéma de compétences : j'encourage les professeures à montrer que cette expérience leur permet de développer le management de projet, la capacité d'organisation…
SV : Il y a un double effet. D'abord, les femmes ont moins tendance à postuler, parce qu'elles ont peur de ne pas avoir l'ensemble des compétences. Le premier obstacle, c'est l'autocensure. Ensuite, il y a des effets de cooptation, cette tendance à nommer quelqu'un qui nous ressemble, en l'occurrence un homme. Maintenant, il y a une vraie prise de conscience que la présence de femmes dans ces milieux est un plus. Preuve s'il en fallait : Xavier Niel m'a mise à la tête de 42 et Roxanne Varza, à la tête de Station F.
Le fait d'être une dirigeante aide-t-il l'empowerment de vos étudiantes ?
A l'unisson : Enormément !
AL : En tant que directrices, c'est à nous de préparer les savoir-être et les savoir-faire pour que les hommes soient plus inclusifs et que les femmes montent dans l'entreprise sans en avoir peur. Par exemple, au moindre dérapage sexiste d'un prof de la Web School, il n'enseignera plus. Cette posture radicale a été révélatrice pour mes étudiants.
SV : Être une femme peut inspirer les étudiants. J'ai beaucoup de retours d'étudiants qui me remercient, y compris les garçons : ils sont aussi heureux et fiers d'avoir à la tête de leur école une femme qui fait bouger les choses. C'est aussi notre devoir de davantage rendre mixte le personnel des établissements, et pas seulement les étudiants. Mais j'ajouterais que le fait d'être une femme en soi ne suffit pas, il faut s'investir en faveur de l'égalité. Par exemple, nous avons monté un partenariat avec Pôle emploi pour faire découvrir les métiers du code aux femmes.
FD : J'ai le sentiment que les directeurs d'école hommes continuent de réseauter énormément et qu'on n'a pas forcément le réflexe de s'entraider entre femmes ou de rentrer dans ces réseaux. Je suis à la commission permanente de la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs) depuis longtemps et, il y a deux ans, je me suis rendu compte qu'ils parlaient des sujets comme s'ils les avaient déjà abordés entre eux. Et c'était le cas. Il y avait eu un « before » entre hommes avant les réunions. Je n'ai jamais pu pénétrer le « before », auquel aucune femme ne participe. A nous aussi de créer nos clubs et de rentrer dans les bureaux.
Êtes-vous favorables aux quotas pour féminiser les directions des grandes écoles et des entreprises ?
FD : J'ai le sentiment qu'il en faut pour faire bouger les choses. Néanmoins, il faut que la femme qui en bénéficie clarifie vite dans sa tête qu'elle est là pour ses compétences. Il faut continuer à travailler sur le mentorat, en disant aux femmes (et aux hommes) de savoir saisir les opportunités sans réfléchir. Si on vous propose quelque chose, c'est peut-être qu'on a vu des choses en vous que vous n'avez vous-même pas réalisées. Ne vous comportez pas en fille, arrêtez le syndrome du prince charmant qui va vous réveiller, on est dans une compétition !
Les quotas, c'est souvent un gâchis du présent pour un meilleur lendemain.
Sophie VigierDirectrice de l'école 42
AL : Avec ou sans quota, les femmes ont constamment le syndrome de l'imposteur, alors autant qu'elles prennent les postes qu'elles méritent ! J'ajouterais qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la question de la sororité. Il y a beaucoup de clubs de femmes (ce qui rend d'ailleurs les hommes dingues). Ce qui me frappe dans ces réseaux, c'est la capacité à être très cash, y compris sur les sujets compliqués. Les femmes prennent moins de pincettes et sont dans le « faire ensemble » entre elles.
SV : Les quotas, c'est souvent un gâchis du présent pour un meilleur lendemain. Cela peut faire douter les femmes sur leurs compétences, alors il faut les manipuler avec précaution. Si j'avais mis des quotas pour les étudiantes de 42 et prononcé explicitement le terme, cela aurait provoqué une explosion. Pourtant, nous avons bien aujourd'hui des places réservées pour la fameuse épreuve éliminatoire de la « Piscine », de sorte que les filles soient suffisamment en nombre pour se sentir légitimes et réussir cette épreuve. Et ça marche !
AG : Personnellement, je suis très favorable aux quotas à la tête des écoles.
En 2021, les diplômées femmes démarrent toujours leur carrière avec une rémunération inférieure à celle des hommes. Comment changer la donne ?
AG : Dans les écoles de commerce, l'écart de salaires se réduit mais reste aujourd'hui de l'ordre de 7 à 8 %. Pour moi, il y a deux leviers. D'abord, savoir négocier - et nous devons donner ces compétences à nos élèves. Ensuite, une action sur les entreprises elles-mêmes, qui doivent être transparentes dans leurs bilans sociaux. Et de faire, le cas échéant, un effort de rattrapage. Tout est en train de bouger, et je suis plutôt positive : je pense que ce sujet n'en sera plus un dans quelques années.
FD : Il serait bien qu'on pointe les secteurs en retard et les secteurs qui font des efforts, et qui ne discriminent plus. Ensuite, dans la négociation du salaire, on a observé que les femmes discutaient de leur fixe mais pas de leur part variable. On se retrouve ainsi avec des hommes qui ont des primes énormes dès la première année et pas les femmes.
Dans les écoles de commerce, l'écart de salaires se réduit mais reste aujourd'hui de l'ordre de 7 à 8 %.
Alice GuilhonDirectrice de Skema Business School
AL : Aujourd'hui, les grands groupes ont des grilles de salaires. Le travail sur l'égalité salariale est surtout à faire dans les start-up. Chez certaines, il y a tout à faire ! De même, le tissu industriel des PME et ETI est encore dominé par une forme de patriarcat et a plus de mal à bouger. Mais le mouvement de fond est là.
SV : Certaines pratiques doivent cesser. Par exemple, demander le salaire précédent pour s'ajuster. Il faut refuser ça, car ça renforce le statu quo. Il faut accompagner les jeunes femmes, leur dire qu'avant un entretien d'embauche, elles doivent demander à des salariés de l'entreprise combien ils sont payés. Et ajouter 10 %.
AL : Une anecdote : dans un de mes recrutements, on m'a énoncé le salaire. J'ai simplement répondu : « Très bien, par contre, si je découvre un jour qu'un équivalent masculin gagne plus, je démissionne dans le quart d'heure. » J'ai eu une augmentation de 42 % en cinq minutes.
Au contact de vos étudiants, quels sont les clichés sexistes que vous constatez encore en 2021, de la part des femmes, comme des hommes ?
AG : (Soupir.) Encore aujourd'hui, les garçons vont en finance, les filles vont en communication. Ca va mieux, car il y a cinq ans, les étudiants qui choisissaient la finance de marché étaient encore à 100 % des hommes. Aujourd'hui, sur cent étudiants, on a quinze filles.
FD : Dans les filières ingénieur, le garçon fait « procédés », la fille fait « qualité » ou « marketing ». Et derrière, le garçon va préférer un métier incarnant le management hiérarchique, alors que la fille mise sur le management transversal.
La tech et l'ingénierie recrutent plus que la communication et le marketing, surtout en ce moment. Mais les filles sont encore réticentes à s'orienter vers ces filières… Qu'est-ce qui coince ?
AG : Quand les étudiants arrivent chez nous, la messe est déjà dite. Ce qu'il faut, c'est arriver à démystifier les choses en amont. L'Education nationale doit apprendre aux filles à oser. Il faut expliquer et casser les stéréotypes.
Avec ou sans quota, les femmes ont constamment le syndrome de l'imposteur, alors autant qu'elles prennent les postes qu'elles méritent !
Anne lalouFondatrice et directrice de la Web School Factory
SV : Il y a un important travail à faire dans la manière très genrée dont on éduque les enfants. Et aussi ne pas négliger la question des « role models » pour se projeter dans de nouveaux métiers. La fiction (le cinéma, les séries) aide aujourd'hui un peu plus… Mais il faut agir sur le terrain : avec 42, on commence en septembre une expérimentation d'apprentissage du code chez les enfants pour déclencher des vocations chez les jeunes filles.
AL : Notre corps professoral a la capacité d'aller chercher quelqu'un pour lui dire : « Oui, ce métier est fait pour toi ! » D'ailleurs, régulièrement, les entreprises nous appellent pour nous demander : « Vous auriez des filles développeurs ? »
Le sexisme en école et plus tard en entreprise, en particulier là où les femmes sont très minoritaires, peut agir comme un repoussoir…
SV : On vit dans un monde sexiste, donc naturellement, durant le stage, les étudiants peuvent rencontrer ce type de problème. Les entreprises de la tech veulent embaucher plus de femmes, elles doivent être accompagnées. Sur les blagues sexistes, il y a quand même une certaine prise de conscience collective.
AG : Je confirme que les gens se tiennent davantage à carreau. En tout cas, au premier dérapage sexiste en stage, on rompt la convention. C'est immédiat. Mais les pires situations de sexisme s'opèrent quand les étudiants sont entre eux, avec de vieux relents nauséabonds.
FD : A l'EBI, c'est particulier, car il y a 80 % de filles. Attention, un groupe de filles dominant peut se comporter comme n'importe quel groupe dominant, qui opprime l'autre. Lors d'un projet, il m'est arrivé d'intervenir pour que les filles n'imposent pas aux hommes de faire à manger ! En revanche, cela apprend aux jeunes hommes à côtoyer des femmes de pouvoir…
Récemment, il y a eu une multiplication des dénonciations de harcèlements, violences sexistes et sexuelles sur les réseaux sociaux, des comptes « BalanceTon/Ta… ». Faut-il en passer par là pour avancer sur ces sujets ?
FD : Si l'on « balance » ainsi, c'est qu'il y a un système qui n'autorise pas la parole, où la parole n'est pas écoutée… Je pense que c'est très important que les victimes puissent parler.
AL : J'ai été terrifiée par l'ampleur de #MeTooInceste, qui m'a très profondément ébranlée. Sur des sujets comme ça, on remarque la puissance de cette méthode. Sur un certain nombre de sujets clés, y compris l'absence de femmes dans certains secteurs, cette expression sert de révélateur et oblige les acteurs à bouger. Même s'il ne faut pas s'illusionner non plus. Dire tout ce que l'on pense dans l'immédiateté reste fragile et dangereux.
Lire aussi :
Une récente tribune de 120 responsables de réseaux féminins appelle à une « relance plus paritaire ». Par quelles mesures un tel souhait peut-il s'incarner ?
SV : Il faut des quotas, des revalorisations salariales, l'accompagnement dans l'entrepreneuriat, des financements (très peu de start-up avec des femmes à leur tête sont soutenues)… Des mesures claires et pragmatiques.
AL : Sur l'inclusion et la diversité, je suis convaincue que le mérite peut relancer l'ascenseur social à la française. Ce dont on s'est rendu compte, à l'école, c'est que la réussite passe aussi par les codes, que l'on maîtrise plus ou moins selon d'où l'on vient. Nous avons mis en place des conférences sur « C'est quoi les codes ? » (de l'entreprise, du fonctionnement en société, etc.). Succès immédiat auprès de nos étudiants !
Julia Lemarchand, Florent Vairet, avec l'aide de Camille Wong et Ariane Blanchet